Une histoire géniale
Qu’est-ce qui distingue le génie du reste de l’humanité ? Ses talents exceptionnels ? Ses fulgurantes intuitions ? Sans doute. C’est surtout son rejet des convenances et de la pensée admise qui en font cet être à part et surnaturel.
« Le génie, c’est 1 % de talent et 99 % de travail acharné. » La citation est bien connue. Elle est d’Albert Einstein, à qui on demandait le secret de ses géniales intuitions. Elle pourrait répondre, quatre siècle auparavant, à celle de Michel-Ange, autre génie devant l’histoire, mais dans un tout autre domaine : « Si les gens savaient à quel point j’ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s’étonneraient plus. » Comme quoi l’idée de génie n’est déjà plus au XVIe siècle, en pleine Renaissance italienne, celle développée par les penseurs antiques, pour qui il était l’expression d’une inspiration divine. Il n’est plus uniquement ce médium à travers lequel les dieux communiquent avec l’humanité. Le génie sait aussi mouiller la chemise.

Artiste divin
C’est au Moyen Âge que la perception du génie change. Dans un contexte pourtant dominé par la religion, on assiste à l’émergence de figures considérées comme exceptionnelles pour leurs contributions à des disciplines, disons, plus terre à terre. Au génie intellectuel et spirituel incarné par saint Augustin, s’ajoute des personnalités telles qu’Albert le Grand, théologien mais aussi pionnier dans l’étude de la nature, et bien sûr les artistes. Même si le génie n’est plus une manifestation divine, l’idée reste qu’un peintre, un sculpteur, un architecte ou un orfèvre qui représente parfaitement l’image de la Vierge ou du Christ est directement inspiré par Dieu. Et qu’à ce titre, il occupe une place à part dans la société des hommes.
L’artiste génial profite ainsi de largesses, matérielles et morales, son comportement et ses excentricités se trouvant souvent excusés par son statut particulier. Lorsqu’il peint le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria della Grazie à Milan, Léonard de Vinci utilise une sorte de peinture à base d’huile liée avec de l’œuf, au lieu de celle à fresque, une technique pourtant mieux adaptée mais qui nécessite une certaine organisation et de la rapidité. Mais le maître n’aime ni l’une ni l’autre. Occupé à d’autres chantiers, le peintre travaille « quand lui en venait l’envie ou la fantaisie », écrit, un brin agacé, le prieur du couvent qui convoque le peintre et Ludovic Sfroza, le duc de Milan, pour se plaindre de ces lenteurs. Léonard lui rétorque que s’il le poursuit dans son harcèlement, il donnera sa tête à la figure de Judas ! Fin de l’histoire. Chef-d’œuvre absolu, sa Cène est inaugurée en 1498, trois ans après son premier coup de pinceau.

Du fait de la technique choisie par Léonard, la peinture murale va très vite s’abîmer. Les Dominicains s’en plaindront auprès de l’auteur qui ne s’en inquiétera jamais vraiment. « Léonard est un homme aux qualités inégalées et doué d’une grâce divine », écrivait Vasari dans son ouvrage consacré à la vie des artistes célèbres de son temps, accentuant ainsi la perception du génie comme une qualité exceptionnelle, à la fois naturelle et presque surnaturelle.
Astre noir
Si l’artiste hors norme a quelque chose à voir avec dieu, il doit aussi forcément posséder sa part de diable. Michel-Ange est traversé par le doute et la colère. L’impulsivité du sculpteur Benvenuto Cellini le pousse à la violence et au meurtre. Parce qu’il a du génie, et grâce à l’influence politique de ses protecteurs, il échappe à la potence. Mais aucun autre peintre plus que Le Caravage ne porte en lui cette dualité mi-ange, mi-démon.
Susceptible, irritable et bagarreur, il est, en revanche, le plus génial des artistes du XVIIe siècle. Le naturalisme de ses toiles, la technique du clair-obscur qu’il pousse à son paroxysme et la justesse de ses compositions sont sans égal. Il fascine les riches Romains qui se précipitent dans son atelier. Il compte parmi ses commanditaires, des cardinaux proches du pape et de puissantes familles comme celle des Borghese. Son sale caractère l’envoie régulièrement en prison, dont il sort toujours. En 1606, il tue le fils d’un membre de la noblesse au cours d’une rixe. C’est le coup de trop. La justice le condamne. Il doit fuir la capitale pour Naples, s’exile ensuite vers Malte et la Sicile. Il apprend que le pape lui a accordé sa grâce. Le voilà de retour à Naples où il sera retrouvé mort dans des circonstances jamais élucidées. Malgré son parcours criminel, partout où Le Caravage est passé, les commandes ont afflué et l’ont enrichi. Personne n’a oublié ni qui il est, ni ce qu’il a fait, mais son génie l’a absout et a racheté toutes ses dérives.

Liberté de penser
Le XVIIIe siècle est moins enclin a accepter cette image d’un astre noir socialement inadapté. Les philosophes et écrivains des Lumières mettent plutôt en avant la raison, l’esprit critique et la capacité à éclairer les autres pour ainsi contribuer au progrès de l’humanité. « Le génie consiste à donner à des vérités connues une forme nouvelle », écrit Voltaire qui met à profit son talent littéraire et son esprit incisif pour dénoncer l’intolérance de la religion et promouvoir la liberté de penser. Pendant ce temps, Diderot lance son projet de grande encyclopédie. Pour dire aussi que les génies ne se trouvent plus forcément dans les arts visuels. C’est la musique qui désormais exprime l’état génial dans lequel elle met le monde en harmonie. Ceux qui y parviennent accèdent à des rangs quasi divins. C’est Mozart, Bach, Haydn, Haendel, Vivaldi, Lully, Corelli, Scarlatti, Rameau, Couperin et beaucoup d’autres. Et plus tard Beethoven qui va balayer la manière baroque alors que l’esprit romantique plane sur la culture européenne. Sans oublier Clara Schumann, compositrice et interprète phénoménale qui joue partout en Europe alors qu’elle n’a que onze ans, mais que l’histoire a complètement effacée, lui préférant son mari Robert, pourtant, à son époque, bien moins connu qu’elle.
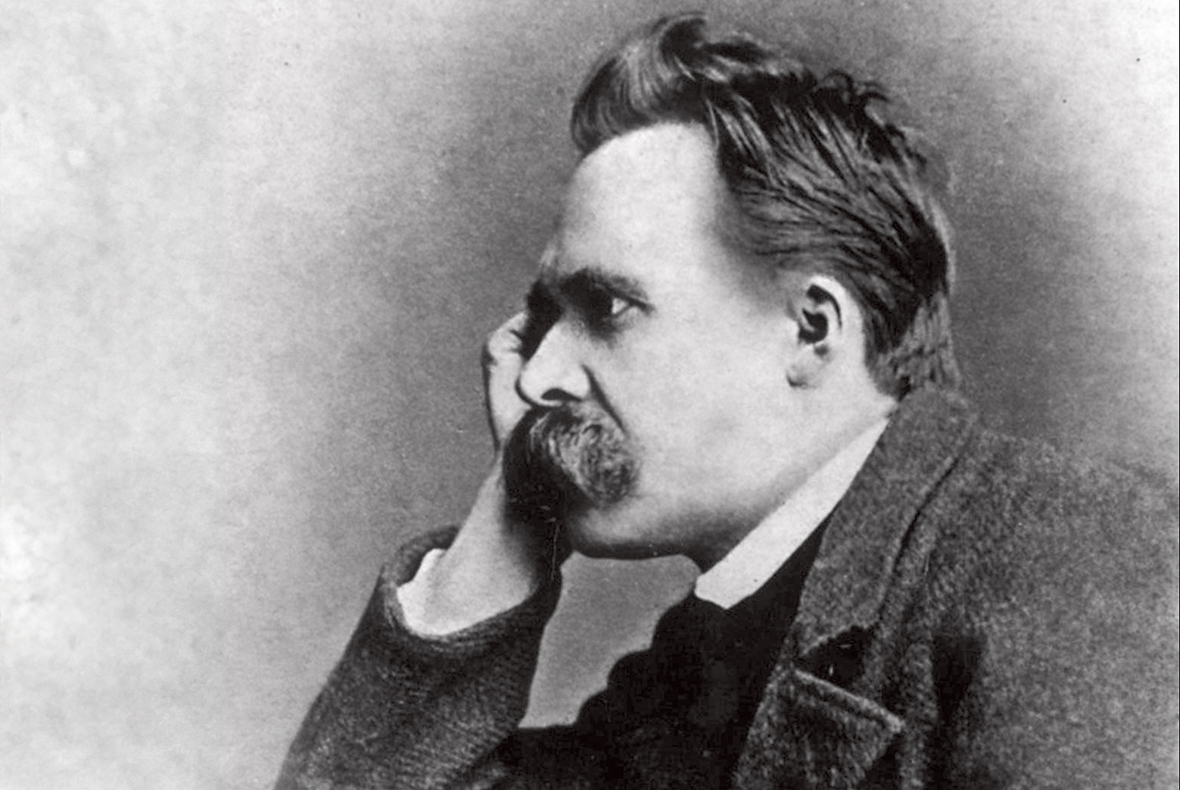
Revient alors, au XIXe siècle, cette idée que le génie pourrait naître des affres de l’âme. Cet intranquillité intérieure, libérée du carcan des conventions, exprimerait ainsi une vision du monde à l’état brut. Mary Shelley crée Frankenstein lors d’une nuit d’orage sur les bords du Léman. Nietzsche, qui a beaucoup écrit sur le génie, est frappé de folie en plein cœur de Turin. Le philosophe du surhomme passera les dernières années de sa vie dans un asile à s’identifier au Christ et à Dionysos.
Ce tiraillement entre la raison et les démons qui fait naître des intuitions géniales est aussi à l’œuvre dans une toute nouvelle figure issue du progrès au XIXe et surtout au XXe siècle : le génie scientifique.
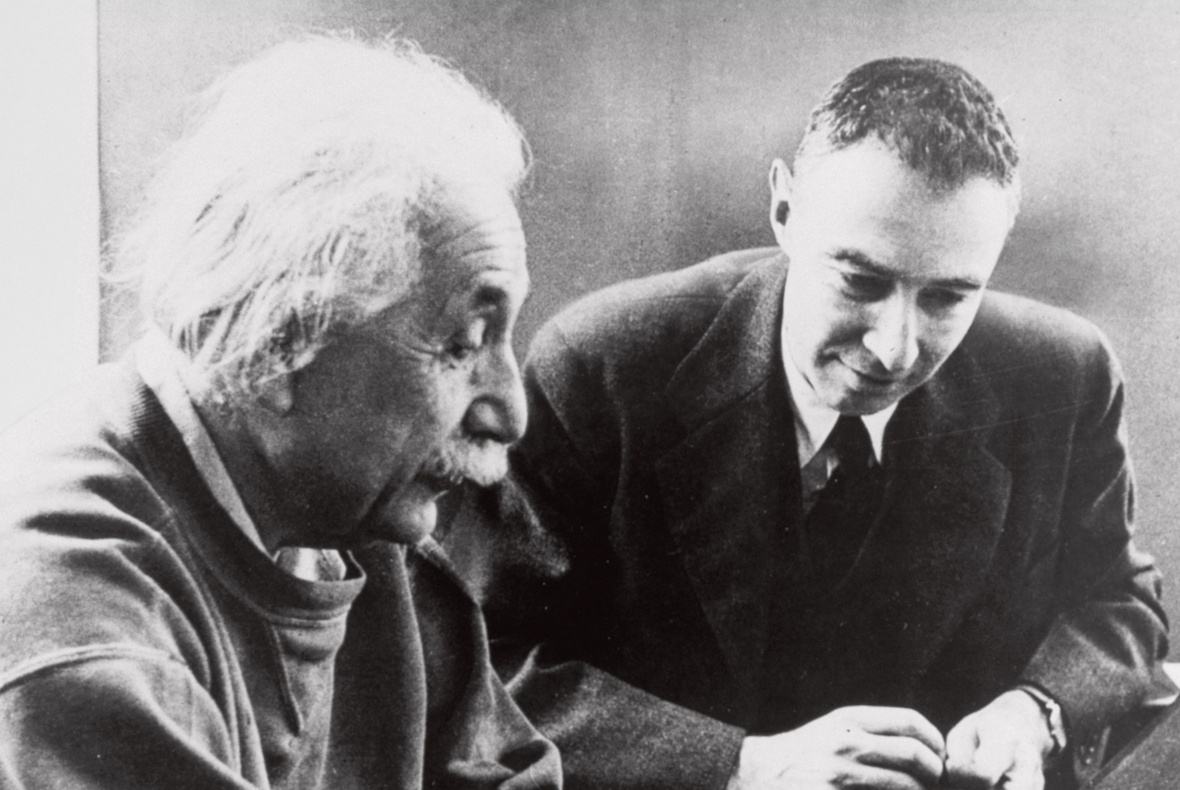
Avec le docteur Frankenstein capable de donner la vie à un puzzle macabre de cadavres, Shelley inventait le savant fou. Albert Einstein ou Robert Oppenheimer n’ont jamais été traversés par la démence. Les conséquences de leurs découvertes – la théorie de la relativité pour le premier, l’arme atomique pour le second – les ont, en revanche, rangés dans la catégorie des génies ambivalents, capables de faire avancer la connaissance de l’Univers, tout en donnant à l’humanité les moyens de le détruire.
Jobs et Musk
La littérature avait personnifié le génie du mal à travers les personnages de Fu Manchu ou de Fantômas, ces êtres capables des pires cruautés pour régner sur le monde. La Seconde Guerre mondiale va les incarner avec les dictatures d’Hitler et de Staline. À Hollywood, les histoires de ces mauvais génies attirent les foules dans les cinémas. Ceux qui les fabriquent accèdent à leur tour à cet Olympe détraqué. Réalisateur et producteur de films à grand spectacle, ingénieur aéronautique surdoué, hygiéniste obsessionnel et milliardaire excentrique, Howard Hughes finira cloîtré pendant huit ans dans la chambre d’un palace d’Acapulco, passant ses journées, shooté à la morphine, à voir des films complétement nu en refusant de se couper la barbe et les ongles. À sa mort, il laissera une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars.
Et aujourd’hui, pourrait-on qualifier de génies les créateurs bien plus policés de la Tech ? Marc Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (ChatGPT), Bill Gates (Microsoft), Larry Page et Sergueï Brin (Google) ont sans doute eu beaucoup de talent, et parfois de chance, pour sentir le vent tourner et en profiter. De là à en faire des esprits géniaux…
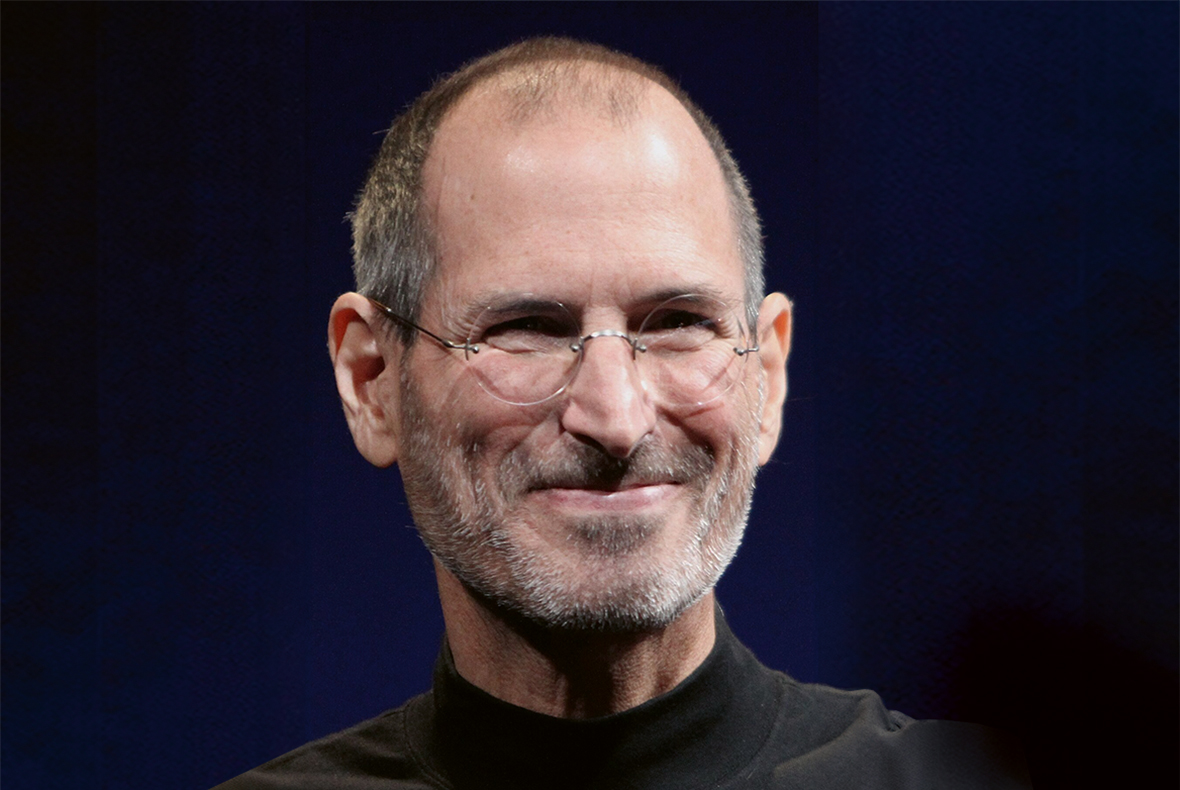
Deux, peut-être, pourraient revendiquer ce statut si particulier qui nécessite de penser de travers et de ne surtout pas suivre les normes. Steve Jobs, cofondateur d’Apple avec Steve Wozniak, qui a porté, contre vents et marées, sa vision d’une société unifiée grâce aux technologies de la communication. Et Elon Musk, entrepreneur inspiré au comportement parfois erratique, militant acharné de la liberté d’expression totale, qui veut révolutionner l’automobile avec ses voitures électriques et catapulter l’humanité sur Mars. Les deux partagent aussi cette croyance imperturbable de penser avoir toujours raison. Le génie, c’est aussi un peu cela : ne jamais douter de rien. ■


