Le monde selon… Frédéric Gros
Le philosophe français, né en 1965, vient de publier « Pourquoi la guerre ? » chez Albin Michel.
Un ouvrage aussi actuel que complémentaire de ses précédents essais sur la honte et la désobéissance, pour un contenu parfois oppressant et pessimiste ?
Certes, mais avec des pistes qui démontrent sa formidable jeunesse dans sa façon d’envisager le monde.

À quoi ressemble le monde selon Frédéric Gros ?
C’est un monde en bout de course, qui se cherche un futur. Un monde qui se voit sommé de se construire dans l’horizon de la catastrophe, et même dans son imminence. L’imminence, c’est cette catégorie temporelle tout à fait particulière du « ça a déjà commencé ». On va devoir restructurer nos existences, nos subjectivités, nos passions. La catastrophe prend aujourd’hui une coloration plutôt climatique, mais ce n’est pas la première fois que ça arrive. Le christianisme s’est construit comme ça, finalement. L’enfance du christianisme, c’est cet horizon-là, l’imminence d’un retour du Christ, qui était revenu juste pour dire « je reviendrai encore, mais cette fois, ce sera pour en finir ». Et finalement, il aura eu une très longue histoire… Nous ne sommes pas dans la certitude de la fin du monde, mais il existe cet appel à bouleverser nos vies de fond en comble.
Le titre de votre dernier livre, «Pourquoi la guerre ?» est terrible parce qu’on peut y lire un sous-entendu d’inéluctable, comme un phénomène qui accompagnera l’humanité jusqu’à sa fin.
Elle l’a en tout cas accompagnée depuis ses débuts, depuis les formations des premières sociétés humaines au néolithique. Elle semble donc consubstantielle à l’humanité, ce qui fait que des philosophes comme Kant et Leibnitz ont parlé de la « paix des cimetières », avec la mort comme seul « endroit » où la paix pourra régner. Pourquoi la guerre ? résonne comme une question très enfantine et très sérieuse, et peut-être que la philosophie est la seule forme de pensée qui se met au défi de répondre aux questions très sérieuses des enfants. Alors qu’être adulte, finalement, c’est peut-être simplement les oublier…
Ça peut être inquiétant pour des générations qui n’ont pas vraiment connu la guerre, ou plutôt qui n’ont pas voulu voir ce qui se passait tout près ?
Vous avez raison de préciser, oui. Car j’ai été frappé par la massivité de la parole éditoriale, en février-mars 2022, qui parlait du retour de la guerre, comme si elle avait disparu depuis près de cinquante ans. Ou alors on ajoutait « en Europe », en prenant soin d’oublier les massacres en ex-Yougoslavie. La guerre n’a jamais cessé sur le plan mondial. Dans ma génération, celle née dans les années 60, on est nombreux à avoir vécu dans l’illusion de la normalité de la paix.
Comment expliquez-vous la capacité d’oubli aussi forte d’une génération sur l’autre, ou alors le manque d’efficacité de la transmission ?
C’est une tendance qui a été notée avec beaucoup de cruauté par Freud : celle de nous bercer d’illusions, de ne pas vouloir affronter le réel et aussi de détester la vérité, celle qui fait mal, la vérité impossible à penser, que Nietzsche qualifiait de « sens tragique de la vérité ». On a été conforté là-dedans par la construction européenne fondée sur l’idée de « regardez, au moins, on ne se fera pas la guerre ! » alors qu’il s’agissait surtout de la construction d’un grand marché avec des effets délétères sur le plan social.
Avez-vous été victime vous aussi du piège de la guerre impossible en Ukraine, celle qui ne pouvait pas avoir lieu, car c’était trop gros ?
Je suis totalement tombé dedans, je n’ai rien vu venir ! L’illusion avait été bien entretenue par des politistes de renom, qui parlaient de farce. Je crois qu’on manque d’imagination, et je ne parle pas ici de pouvoir envisager des scénarios improbables, qui restent la forme d’imagination la moins intéressante. Je parle de l’imagination comme capacité à se mettre à la place de quelqu’un. On ne mesurait pas à quel point les Russes ont pu se sentir humiliés quand on a applaudi les révolutions ukrainiennes, quand on disait que les Ukrainiens allaient enfin s’ouvrir à la liberté. Après, les reconstructions historiques sur l’Ukraine, cœur battant ou non de la Russie, c’est de la fiction. Il n’y a pas de vérité possible à ce niveau, c’est juste ce qu’on a envie de croire. Alors pourquoi voit-on si mal venir les guerres ? À cause de l’illusion, évidemment, mais aussi par le manque d’imagination. Il faudrait savoir se transporter dans la rage et la colère des autres. Et ça existe aussi de manière très forte politiquement parlant. On ne voit pas à quel point les peuples engrangent de la rage et de la colère devant ce qu’on leur fait subir.
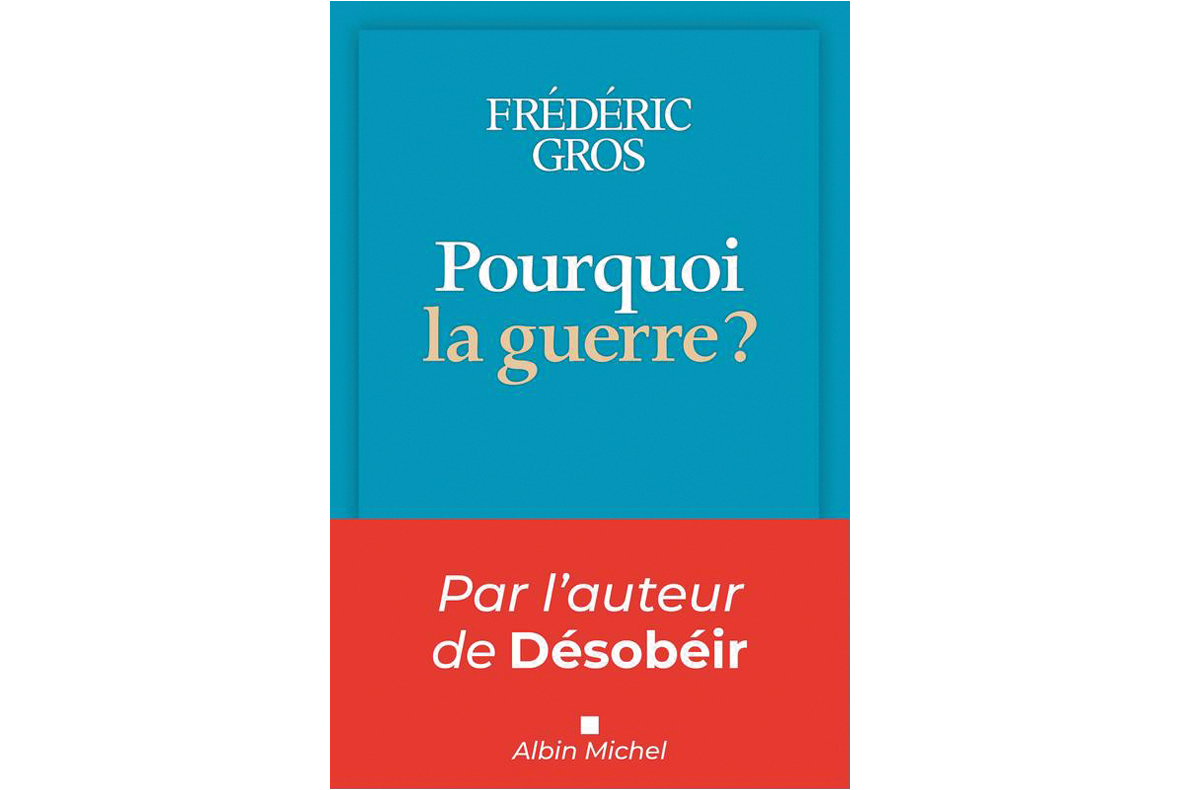
Vous citez Kant ainsi : « Il faut qu’il reste même dans la guerre une sorte de confiance dans les principes de l’ennemi, autrement on ne pourrait jamais conclure de paix. » C’est une façon de dire que vous êtes partisan de la non-humiliation de Poutine en cas de négociation ?
(Longue hésitation) C’est une question qui me trouble. Quand Emmanuel Macron a parlé de ne pas humilier Poutine, il s’est reçu de telles « avoinées moralisatrices » que ça a fragilisé ma position première qui était : évidemment qu’il ne faut pas l’humilier ! À partir du moment où on considère Poutine comme président d’un État souverain et que le règlement de la guerre se fera par un traité de paix, on n’a pas le choix. Une hypocrisie criminelle, selon certains ? Peut-être, mais au regard de l’histoire, elle sera sans doute moins dévastatrice qu’une humiliation qui va en rajouter dans la rage et qui sera le carburant de guerres futures. Le problème des traités de paix, c’est aussi de ne pas nourrir de futures guerres. Et dans l’humiliation, vous préparez des retours du refoulé. Alors quand il s’agit d’un pays qui dispose de l’arme nucléaire…
Il a été pourtant suffisamment démontré que c’est l’humiliation de l’Allemagne dans le traité de paix en 1918 qui a entraîné la suite.
C’est ce qui m’interroge : pourquoi, aujourd’hui, notre puissance moralisatrice obscurcit-elle tout ça ? Je souscris au fait que Poutine est un fauteur de guerre. Mais ne pas vouloir négocier au motif que c’est lui et sa folie qui ont commencé ? Là, ce n’est plus enfantin, mais infantile. Des hypocrisies peuvent paraître monstrueuses, mais les diplomates se sont toujours comportés comme ça au fil de l’histoire.
Vous citez également Sartre dans «La critique de la raison dialectique», qui définit la rareté comme « la grande responsable des violences interhumaines ». Vu toutes les raretés qui s’annoncent à court terme, doit-on s’attendre à des guerres permanentes et universelles ?
On s’est laissé entraîner par le fait que le commerce obligerait l’humanité à entretenir des relations pacifiques. C’est tout le rêve des Lumières et de la fin du XVIIIe siècle : instaurons des règles et la rivalité commerciale se substituera à la folie guerrière. On y a cru pendant presque deux siècles. Sauf qu’en début de XXIe est apparu un élément qui, jusque-là, ne l’était pas dans sa radicalité : la rareté des ressources, certaines en nombre fini. On n’est plus dans le gagnant-gagnant des échanges, mais dans les « c’est à toi ou c’est à moi ». On se dirige, avec la fin de siècle comme horizon, vers des guerres de plus en plus dures, car ce seront des guerres de prédation. C’est Mad Max, mais en vrai. Machiavel disait d’elles que c’étaient les plus cruelles. Elles ne sont plus comparables aux guerres entre deux états pour corriger les frontières, ces guerres de rectification comme l’Europe en a souvent connu. On n’en sera plus là. Les enjeux seront vitaux plus que symboliques.
Vous avez pris la désobéissance comme thème d’un autre de vos ouvrages. Or, les exils et désertions de soldats et civils russes ont été très médiatisés l’an dernier. Des phénomènes qui ne semblaient pas envisageables au siècle dernier.
L’armée et l’Église ont été les deux grandes matrices de la valorisation et de l’exaltation de l’obéissance en Europe. C’étaient des modèles qui se complétaient, il fallait obéir de manière héroïque et aussi pour son salut. La désobéissance dans ces domaines-là est incomparable à la désobéissance scolaire ou professionnelle, par exemple, car il s’agit de s’arracher à des institutions et à des noyaux où l’obéissance est justement le cœur central. Les formes du refus sont éclatantes et violentes, sidérantes même, avec un tribut à payer beaucoup plus lourd. C’est le pistolet sur la tempe de celui qui veut fuir le front, ou la damnation éternelle. La désobéissance de certains soldats russes possède un éclat très fort ici, elle témoigne d’un courage supérieur. Il faut déjà du courage pour obéir, mais pour désobéir, alors là…
La désobéissance est une vertu qui a porté l’évolution du monde. Vous en parlez comme « une victoire sur soi » et « une victoire contre l’inertie du monde », mais elle est tout sauf naturelle. Pourquoi ?
Je dirais à cause de la peur, mais la peur de beaucoup de choses. Celle de la sanction, mais aussi de la solitude. La peur de décevoir, aussi, car il existe une demande d’amour dans l’obéissance – qu’est-ce que le zèle, sinon ça ? Et peut-être le plus important : la peur de sa propre liberté. La liberté est le droit le plus sacré de l’individu, selon la vieille croyance libérale, mais quand on regarde de plus près les choses, on s’aperçoit que toute liberté équivaut à une responsabilité. Et s’il y a une chose dont on essaie de se démettre, c’est bien de celle-là. Car l’obéissance permet de faire quelque chose sans en porter la responsabilité immédiate.
En France, la violence de la répression contre les Gilets jaunes a beaucoup interpellé. Pensez-vous qu’il existait un danger de désobéissance généralisée tel que la peur a musclé les consignes gouvernementales ?
C’est la naissance de ce que certains penseurs politiques ont appelé le libéralisme autoritaire. Depuis quelques décennies, on constate une espèce de changement assez curieux, car les libéralismes économique et politique s’étaient toujours accompagnés d’une relative tolérance. Mais comme la situation économique devient aujourd’hui plus tendue, ils montrent un visage autoritaire qui ramène à ce que Marx avait appelé le secret le mieux gardé de l’État moderne : n’oubliez jamais que nous sommes avant tout les garants des propriétaires. Les Latins disaient ius utendi et abutendi, ce qui signifie « si je suis propriétaire, c’est que je peux en abuser ». Et pour revenir à Kant, c’est aussi là le secret des guerres. Au fond, les dirigeants se comportent comme les propriétaires de leurs peuples. Et c’est pour ça qu’ils en abusent, en les exploitant ou en les envoyant mourir sur le front.
La guerre n’a jamais cessé sur le plan mondial. Dans ma génération, celle née dans les années 60, on est nombreux à avoir vécu dans l’illusion de la normalité de la paix.
Les actions dans les musées et les bâtiments publics, les jeunes qui s’enchaînent pour protester. Est-ce le début de ce qui pourrait devenir un terrorisme civique ou civil ?
J’hésiterais encore à parler de terrorisme ici, car ces actions n’ont fait aucun mort. Et je crois qu’on n’évalue pas à quel point ça passe mal chez ces jeunes. Ils ont une rage d’être privés du futur, privés d’un futur par les générations précédentes. Il s’agissait jusqu’ici de désobéissance civile, mais elle contient en elle deux piliers. D’abord, c’est une désobéissance publique, pas clandestine. Ils s’enchaînent, ils disent « regardez comme je désobéis ». Et le deuxième principe est celui de la non-violence. Mais pour combien de temps ? Spinoza disait : on ne combat les passions que par d’autres passions. Marx, c’était : on ne combat une aliénation réelle que par des émancipations réelles. Peut-on combattre la violence autrement que par la violence ? C’est le problème qui se pose aujourd’hui, même pour la laïcité : peut-on combattre une religion autrement que par une autre religion ? Viendra le moment qui me fait trembler où certains diront : « de toute manière, il n’y a que ça qu’ils comprennent ». Les actions de plus en plus violentes ont, hélas, beaucoup d’avenir face à l’inertie généralisée de beaucoup de nos dirigeants, mais j’ai encore du mal à envisager sous quelle forme.
Vous êtes professeur en Humanités politiques à Sciences Po. Comment définiriez-vous votre matière ?
C’est une façon d’enseigner la politique où on ne part pas de courbes, de statistiques ou d’une analyse rigoureuse des institutions, mais plutôt de notre patrimoine culturel. On peut comprendre la politique en allant au cinéma, avec les films de Costa-Gavras, en lisant les tragédies de Shakespeare ou Le Prince de Machiavel. La politique est une expérience, elle engage la part à la fois sombre et lumineuse de l’humanité. Il faut réinvestir un certain sens tragique du politique que font oublier les sciences.
Concrètement ?
C’est refuser d’analyser un concept sans passer par une œuvre littéraire, un tableau ou les sciences humaines. C’est tâcher de faire sentir l’expérience. Hannah Arendt évoquait la banalité du mal. Elle disait que la bêtise, ce n’est pas l’ignorance ou le manque de diplômes, c’est juste le fait de ne pas penser ce qu’on est en train de faire. C’est ainsi qu’elle qualifiait celle de Eichmann, qui acceptait, lui, de ne pas être à la verticale de ce qu’il faisait en se cachant derrière des consignes administratives. C’est ça la bêtise, ne pas vouloir penser. Mais je crois que la banalité du mal, aujourd’hui, c’est surtout l’absence d’imagination. À trop formater les jeunes avec des produits cérébraux, à ne pas stimuler leur imagination, on fabrique des politistes sans créativité qui finissent par prendre les statistiques pour la réalité. Certains pensent que je fais de la démagogie ou du bavardage, mais rien n’empêche par exemple d’analyser le concept de catastrophe à partir de l’excellente série Chernobyl.
Votre génération a connu un monde où on voulait aider les chômeurs, en tout cas au moins faire semblant. Aujourd’hui, on les pointe du doigt, on leur met la honte. Et ça marche, car on fait appel à la « valeur travail » qui séduit encore beaucoup de gens.
La honte est bipolaire. C’est une formidable machine à faire obéir, et le néolibéralisme en est un des premiers responsables avec son discours « après tout, si tu trouves pas de boulot, remets-toi en cause ». Et en même temps, à partir du moment où elle est un peu partagée, elle se transforme en colère politique et elle devient révolutionnaire. « La honte est une colère rentrée, et si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion prêt à bondir », écrivait Marx. Quand on s’aperçoit que c’est le système qui est honteux, et pas nous, alors toutes ces « hontes ensemble », ça fait des étincelles.
Les boomers sont accusés de tous les maux par certains radicaux – quand bien même le problème s’est construit depuis des milliers d’années. La colère de ces jeunes-là contre une seule génération vous semble-t-elle malgré tout légitime ?
Oui, il faut accepter de payer, quelque part. C’est la phrase de Primo Levi quand il sort des camps d’extermination et parle de « la honte d’être un homme ». Il poursuit en disant que cette honte-là nous immunise. Il faut accepter cette part de honte, accepter de faire une différence solide entre honte et culpabilité. Je ne me sens pas coupable de la situation actuelle, non. Mais j’ai un peu honte, oui. Et cette honte-là, c’est mon principe de non-indifférence. Un marqueur de solidarité, un minimum syndical. Dire « j’ai juste un peu honte », c’est reconnaître qu’on ne peut pas se désolidariser complètement des tragédies du monde. Ça ne résout rien, mais il faut accepter que ressentir « la honte d’être un homme » témoigne de notre humanité. ■

