Le monde selon… Ilaria Gaspari
La jalousie, la nostalgie, la colère… Comment vivre avec les émotions « négatives » que la société nous pousse à ravaler ? Sans recettes toutes faites, la docteure en philosophie milanaise dit s’adresser à tous les « paumés, assoiffés, agités et imparfaits ». Bref, à toute l’humanité.

À quoi ressemble le monde selon Ilaria Gaspari ?
Ce qui m’apparaît, c’est une image : le monde comme une très grande forêt où tout est connecté : les bâtiments, les arbres, les navires, les contradictions… L’idée, c’est que chaque chose qui existe est vivante et reliée aux autres. Cela me vient de mes études spinozistes, une image comme une nervure du réel. Même les choses qui ne sont pas vivantes ont une vie et une influence. Dans une forêt, si un arbre tombe, il y aura des conséquences pour tous les autres arbres. Pas forcément négatives, d’ailleurs. Peut-être espériez-vous une réponse moins métaphorique ? Mais quand on me demande d’imaginer, ce sont toujours les images qui me viennent en premier.
Vous venez d’adresser aux grands émotifs un petit manuel philosophique. Qui sont-ils exactement ?
En italien, cet ouvrage s’intitule La vie secrète des émotions. En France, « la vie secrète » a été déclinée par les éditeurs sur tout et n’importe quoi depuis le succès de La vie secrète des arbres en 2015. Il fallait trouver autre chose. Je ne sais plus qui a suggéré « grands émotifs », mais j’ai tout de suite pensé que c’était une bonne définition de ce que j’ai toujours été : quelqu’un qui court en permanence le risque d’être écrasée par ses émotions. Une personne très vulnérable, susceptible d’être bouleversée par ce qui se passe en elle et hors d’elle.
C’est quelque chose qui vous définit depuis l’enfance ?
J’ai toujours su que c’était mon destin, depuis que je suis toute petite. Dès la maternelle, je vomissais tous les jours avant d’aller à l’école alors que tout s’y passait bien, simplement parce que j’avais l’angoisse de sortir. Les spectacles me bouleversaient comme si c’était une maladie. Je ressentais une angoisse très profonde à chaque fois que je croisais quelqu’un qui souffrait. Quand j’avais quatre ans, il y avait une fille dans ma classe avec un retard psychomoteur et des problèmes de croissance. Du coup, j’avais décidé d’arrêter de manger pour ne pas grandir, moi non plus, pour devenir comme elle, tellement j’étais perturbée.
Le concept d’intelligence émotionnelle est très récent dans nos sociétés, de même que la reconnaissance globale des émotions. Quel rôle doivent désormais jouer les familles et les institutions pour confirmer cette prise de conscience ?
Des progrès ont eu lieu aussi bien à l’école que dans le cadre familial, certes, mais le problème principal selon moi, c’est qu’on a encore tendance à exclure les émotions négatives de l’expérience. On craint moins de montrer ce qu’on ressent, mais les émotions désagréables sont systématiquement niées. L’angoisse est encore diabolisée. On a besoin d’être éduqués à la jalousie, une émotion que même la meilleure personne au monde peut ressentir. Étouffer les émotions, c’est prendre le risque de les transformer en émotions plus néfastes, plus puissantes, plus proches de la notion spinozienne de « passion triste » parce qu’elles vont finir par nous dominer. Et se changer en rage ou en colère, parce qu’on n’arrive pas à donner un visage à ce qu’on éprouve.
Certains parents tentent tout pour protéger leurs enfants de la souffrance, probablement en réaction à leur propre vécu. Un choix contre-productif ?
C’est ressorti encore plus fort pendant la pandémie, un traumatisme qui a certes cassé nos habitudes, mais qui est venu rappeler que la maladie et la mort font partie de la vie. Il faut s’y confronter, sinon on ne sera jamais prêt à les affronter. Je trouve, encore une fois, qu’on essaie trop de rejeter le fait que des choses désagréables existent. On parle de plus en plus d’algophobie, par exemple, cette peur pathologique de la douleur. De philosophie, aussi, mais c’est un terme qu’on utilise souvent comme une formule de développement personnel. Il faudrait toujours garder en tête la phrase célèbre du Phédon de Platon, reprise par Montaigne, qui dit que la philosophie, c’est l’art d’apprendre à mourir. Savoir mourir, c’est quelque chose qui nous apprend à être libres.
Vous avez visité de nombreux lycées en Italie suite à la parution de votre livre. Qu’est-ce qui est ressorti de ces rencontres ?
Le plus bouleversant dans ce tour des écoles, c’était l’envie et le besoin de parler de ces jeunes, et notamment de leurs émotions désagréables. La jalousie et l’angoisse revenaient le plus souvent, surtout chez les garçons. J’ai à peu près vingt ans de plus qu’eux, mais mes années de lycée ne sont pas si lointaines. À mon époque, il aurait été impossible de s’exposer comme ça en pleine lumière. Les filles, oui, mais pas les garçons, il y aurait eu trop de moqueries devant leur vulnérabilité. Ils étaient touchés que j’écrive sur ce qu’ils ressentaient, et ils le disaient en public.
Les tabous semblent s’évaporer de plus en plus. Vous êtes plutôt optimiste sur la libération de la parole ?
Je ne veux pas nier les crises politique, économique et écologique, le fait qu’on a perdu des points de repère présents depuis longtemps. C’est très facile de se laisser perturber, mais les adolescents apprennent à grandir avec leur ressenti, loin du sentiment de honte comme on a pu le connaître voilà quelques années. On a accepté la vulnérabilité. C’est peut-être dû aux crises, mais c’est un fait.
Le développement personnel nous trompe en soutenant l’idée que nous pourrions changer en profondeur.
Vous animez également des ateliers d’écriture autobiographique. Qu’est-ce qui en ressort ?
La plupart des participants ont généralement entre 50 et 70 ans, même si quelques-uns ont la trentaine. À chaque fois, un lien très fort se crée entre eux, mais aussi avec moi, car je les amène à s’exprimer sur leurs traumas enfouis. Quand ils partagent leurs textes, tous finissent par trouver que leurs douleurs étaient finalement moins terribles qu’ils ne le pensaient. Alors que ce sont des sentiments difficiles à aborder : il y a de la rage face à l’injustice qui ressort, par exemple un frère ou une sœur qui leur était préférée, ou d’autres événements qui remontent à plus de cinquante ans. Mais tout ça est adouci par l’écriture. Ça les délivre.
Vous parlez aussi d’Emilio, le chien abandonné que vous avez recueilli, qui met du temps à redonner sa confiance mais qui y parvient. Le message, c’est de rester fidèle à sa nature, quelle qu’elle soit ?
C’est le message, oui, souvent contraire à ceux typiquement distillés par le développement personnel. Qui se contente de donner des petites astuces, et surtout, qui nous trompe en soutenant l’idée que nous pourrions changer en profondeur. Les grands émotifs sont vulnérables, plus que d’autres, mais ce n’est pas si mal de souffrir un peu, parfois. Si votre nature est de faire confiance, aux autres, à la vie et au monde, alors il faut y rester fidèle. Parce que si on se trahit, on ne fera jamais l’expérience de la vie telle qu’on doit la vivre. Mieux vaut se blesser un peu qu’éviter la blessure.
Certains cherchent pourtant à ne plus souffrir ni à se mettre en colère et partent à la recherche du zen. Sont-ils sûrs d’échouer ? Même le Dalaï-lama avouait s’énerver contre les oiseaux qui lui gâchaient le sommeil en chantant la nuit…
Tout le monde s’énerve. Aristote dit une chose qui est une bonne réponse aux tentatives d’ataraxie, au fantasme du sage qui ne se laisse jamais perturber : le courageux, ce n’est pas celui qui ne connaît pas la peur, mais celui qui la reconnaît et qui est capable de l’affronter. On ne peut pas s’en délivrer, il faut juste apprendre à y faire face. Notre société, souvent, essaie d’effacer la peur. Et ça ne créera pas des gens courageux, mais des inconscients qui n’auront pas les outils pour y répondre.
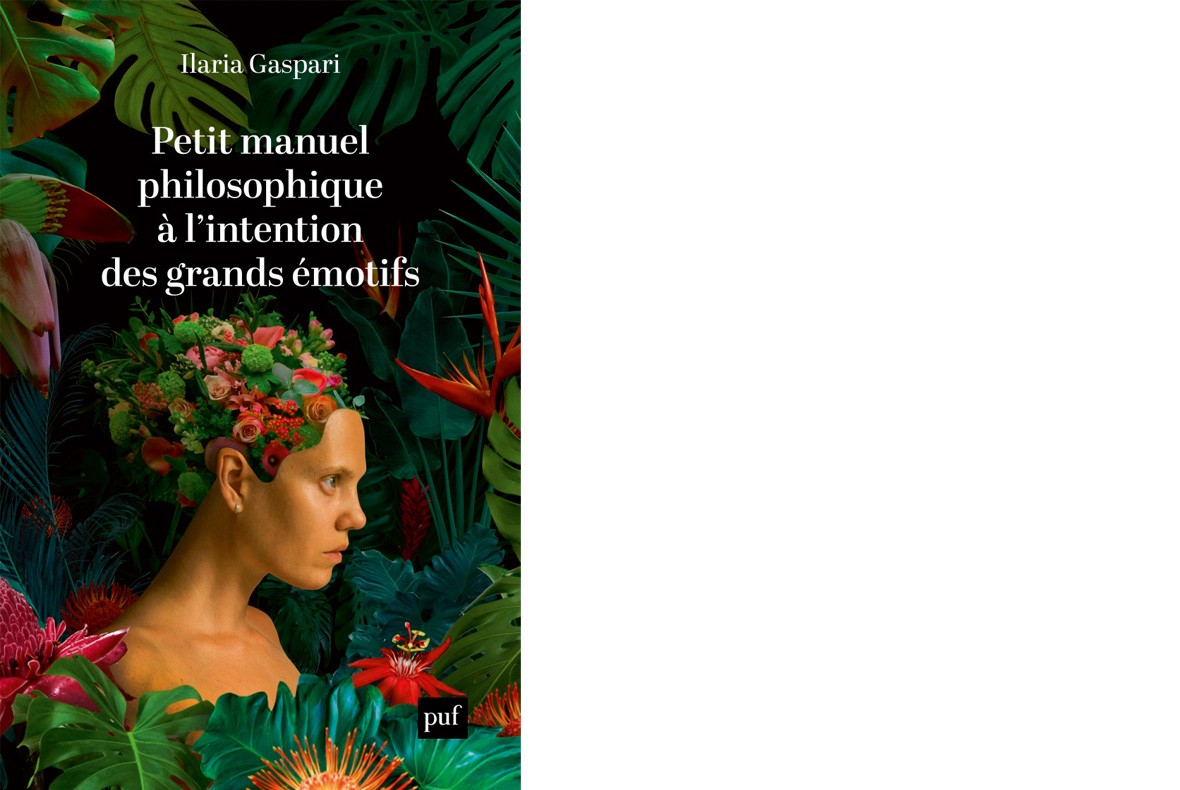
Tout positiver reste compliqué. Comme les crises de panique, par exemple. La médicalisation n’est-elle pas parfois nécessaire ?
Si l’angoisse devient pathologique au point de paralyser, alors on doit faire confiance aux autres et se laisser aider. Mais on ne doit pas médicaliser trop vite, ne pas étouffer les émotions tout de suite. On doit d’abord les éprouver et les entendre. J’ai connu des crises de panique, j’ai dû les écouter pour trouver le moyen d’en sortir avec la thérapie et l’écriture. On ne peut rechercher la normalisation trop rapidement, on doit se donner le temps de vivre les émotions désagréables, qui deviennent parfois très fécondes aux niveaux artistique et esthétique.
On constate un féminisme radical de nos jours, avec parfois des propos excessifs, comme sur la « virilisation » du barbecue. Ce discours peut-il influer de façon néfaste sur les relations hommes-femmes et la gestion des émotions entre les deux sexes ?
On vit un moment de changements avec une grande radicalisation des discours. C’est parfois ridicule, comme avec cette histoire de barbecue dont il vaut mieux rire. Mais c’est surtout une réponse, une forme de rébellion, une manière de s’emparer de la rage et de la colère longtemps interdites aux femmes. Dans la Grèce antique, les personnifications de la colère et de la furie étaient féminines, mais jamais les femmes ne manifestaient de la colère ; sinon les reines et les déesses, mais c’était alors plus proche de la folie. Comme avec Médée, où la seule femme enragée est folle, alors que les héros, non. Aujourd’hui, la rage explose sur des bases qu’on peut estimer mal fondées, mais c’est une réaction. Il y a une fluidification des stéréotypes qui arrive. Les femmes n’avaient pas le droit à la colère, mais elles l’étaient quand même ; les hommes n’avaient pas le droit à la faiblesse, et pourtant ils l’étaient, faibles. Aujourd’hui, cette démarcation rigide s’efface. Je suis optimiste là aussi. Ces changements vont nous rendre plus humains.
Sans vouloir hiérarchiser les émotions, y en a-t-il une plus délicate à gérer que les autres ? La culpabilité, par exemple, qui peut se montrer terriblement envahissante au cours d’une vie ?
Spontanément, je dirais les regrets. Dans les ateliers que j’évoquais tout à l’heure, c’est ce qui revient en force, toujours : j’aurais dû faire ci, je n’ai pas eu le courage de faire ça, etc. En écrivant, les participants se posent la question d’un angle différent et comprennent finalement qu’ils n’auraient pas pu faire autrement à ce moment-là. Le regret est une émotion fascinante, d’une puissance inouïe. Parfois, les gens vivent avec toute leur vie, c’est comme une force énorme qui les empêche de savourer leur quotidien.
La clé de tout, c’est l’acceptation. En résumé, quelles sont, selon vous, les pistes à suivre pour celle ou celui qui part de zéro et qui aimerait sortir de cette aliénation ?
Le livre a été pensé non pas pour donner des recettes toutes faites et dire comment se comporter, mais en citant des exemples de personnes qui ont essayé de se comprendre. Je dirai donc apprendre à se lire. Quand je parle d’analphabétisme émotionnel, c’est ça : vouloir arriver tout de suite à la conclusion, et donc censurer l’émotion alors qu’il faudrait la vivre entièrement. Et l’écriture, encore et encore. Dans mes ateliers, j’encourage mes élèves à transférer leurs émotions sur le papier. C’est le principe de ce qu’on appelle l’écriture graphique, un exercice de compréhension de soi grâce au transfert sur le papier. Et c’est aussi une forme de communication, même si on ne la partage pas. ■