Gisèle Halimi, oser le féminisme
Avec huit décennies de combats passionnés, le cas de Gisèle Halimi est singulier. La célèbre avocate qui s’est battue tant pour la libéralisation de l’avortement que pour la criminalisation effective du viol, a incarné durant plusieurs décennies le féminisme révolutionnaire.
Fille non désirée de parents qui auraient voulu un garçon, Gisèle Taïeb rejette vite les traditions hébraïques de sa famille et refuse le mariage soigneusement arrangé qui l’attend dans cette Tunisie des années 30. Elle fait ses études à Paris, puis milite pour l’indépendance tunisienne, avant d’épouser un fonctionnaire nommé Halimi, de divorcer tout en gardant son nom, puis de se marier avec le secrétaire de Sartre. Avocate, elle prend fait et cause pour les rebelles algériens et milite aux côtés des intellectuels de gauche, défendant notamment Djamila Boupacha, accusée d’avoir déposé une bombe dans un café en Algérie française, et qui a été torturée par des soldats français. Jugée en 1961, sa cliente est condamnée, puis amnistiée lors des Accords d’Évian l’année suivante. Appuyée par Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi devient dans ce contexte l’une des premières à oser dénoncer – avec plainte pénale contre l’État – la « culture du viol », à tel point que même le FLN algérien tentera de contester l’importance de cet aspect de l’affaire Boupacha.
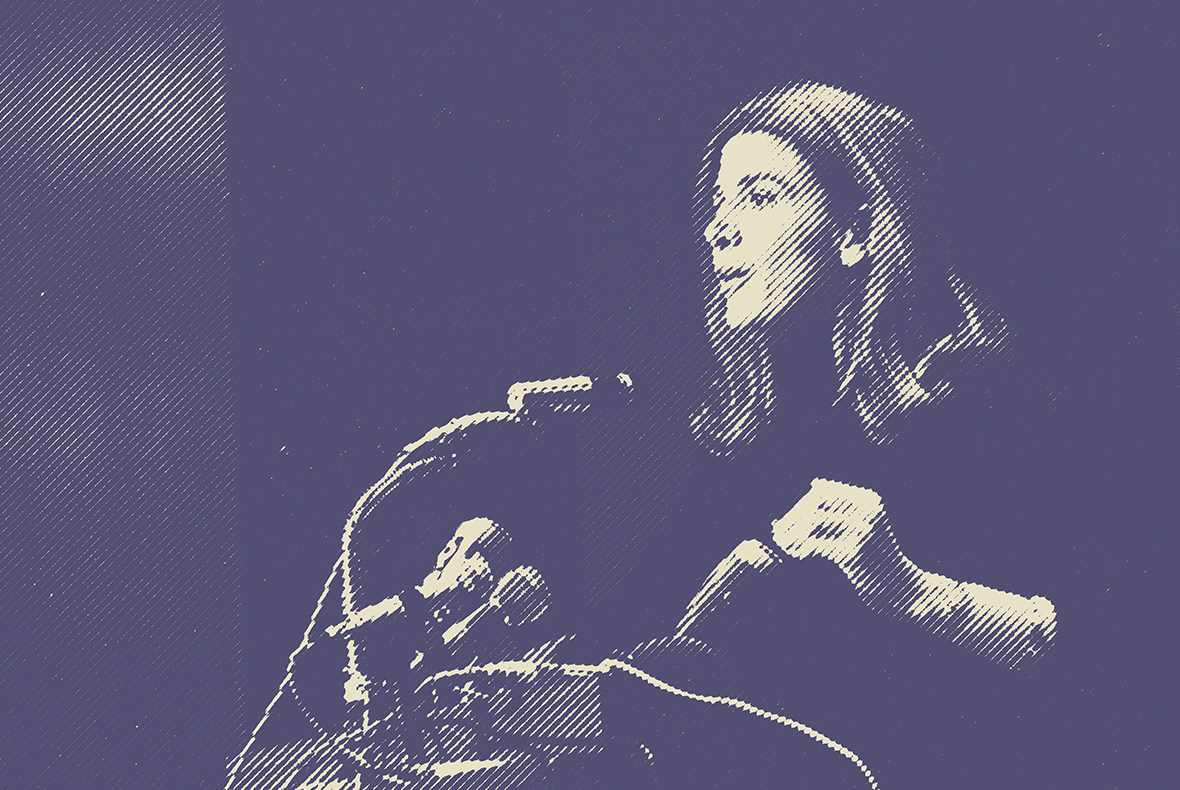
Heure de gloire
La jeune et remuante avocate devient vite le symbole de l’insoumission au pouvoir alors très masculin et conservateur, bien avant mai 68 et des décennies avant le mouvement #metoo. Gisèle Halimi manifeste cependant de l’admiration pour François Mitterrand, pourtant pourfendeur de rebelles algériens en son temps et dont le féminisme n’apparaît pas vraiment à l’époque, en le soutenant lors de sa tentative de conquérir l’Élysée en 1965. Six ans plus tard, on la retrouve en bonne place parmi les signataires du « manifeste des 343 », des femmes annonçant qu’elles ont avorté. Publié dans la presse de gauche, le texte exige la légalisation de l’avortement. Gisèle Halimi, qui a trois enfants, n’hésite pas à évoquer dans un entretien avec un journaliste ses trois interruptions de grossesse.
Son heure de gloire arrivera en 1972, lorsqu’une adolescente de 16 ans qui a avorté et sa mère, qui l’a aidée à le faire, sont inculpées et appellent l’avocate à leur secours. Le procès, auquel Gisèle Halimi consacre toute sa fougue et son talent, avec des coups de théâtre comme le témoignage bouleversant, à l’appui de la défense, d’un illustre médecin catholique, aura un immense retentissement. La jeune fille et sa mère échappent à toute peine et l’on peut considérer que ce jour-là, les juristes commencent à rédiger la future loi Veil de janvier 1975 qui légalisera l’avortement en France.
Le viol est un crime
Gisèle Halimi ne se repose cependant pas sur ses lauriers. L’avocate – même si elle milite contre la peine de mort – n’a pas peur du « saint laïc » Robert Badinter, qu’elle mouche publiquement pour une phrase sexiste qu’il lui a adressée, ni des insultes et des attaques physiques qu’elle subit lorsqu’elle défend deux jeunes campeuses belges violées en Provence. Plaidant leur totale innocence, les trois hommes qu’elles accusent seront condamnés et en 1980, la loi française reconnaîtra le viol comme un crime, et surtout le redéfinira en tant qu’« acte de pénétration », permettant de poursuivre tout une série d’actes violents qui échappaient auparavant à la sanction.
Comme bien souvent en France, la rebelle indomptable, à la cinquantaine, devient une notable, statut logiquement favorisé par l’accession de son ami Mitterrand à la présidence de la République. Gisèle Halimi est élue députée apparentée socialiste, puis devient ambassadrice française à l’UNESCO. Après cette trajectoire institutionnelle, la désormais sexagénaire qui a repris ses activités d’avocate multiplie les interventions médiatiques et se lance dans l’écriture, publiant quinze livres tant sur ses combats (La cause des femmes) que sur des sujets historiques (La Kahina) ou de société.
La militante précoce ruait déjà dans les brancards à dix ans, devient alors l’adversaire du jeunisme qui déploie ses délétères effets. Elle admet qu’à 70 ou 80 ans, il est plus difficile de passer la nuit à préparer un procès, puis de plaider toute la journée au tribunal, mais elle défend avec énergie l’importance de l’expérience. « Il ne faut jamais se dire qu’on est fini, qu’on est entré dans la vieillesse », commentait-elle en dédicaçant le dernier de ses ouvrages, Histoire d’une passion, à 84 ans. Disparue en 2020 à l’âge de 93 ans, Gisèle Halimi, en traversant son siècle, aura en tout cas mené des combats dont bien des jeunes d’aujourd’hui n’imaginent pas le courage et l’énergie qu’ils exigeaient.
Exclusivité web


